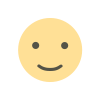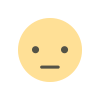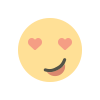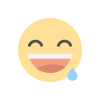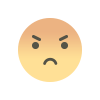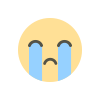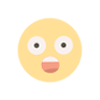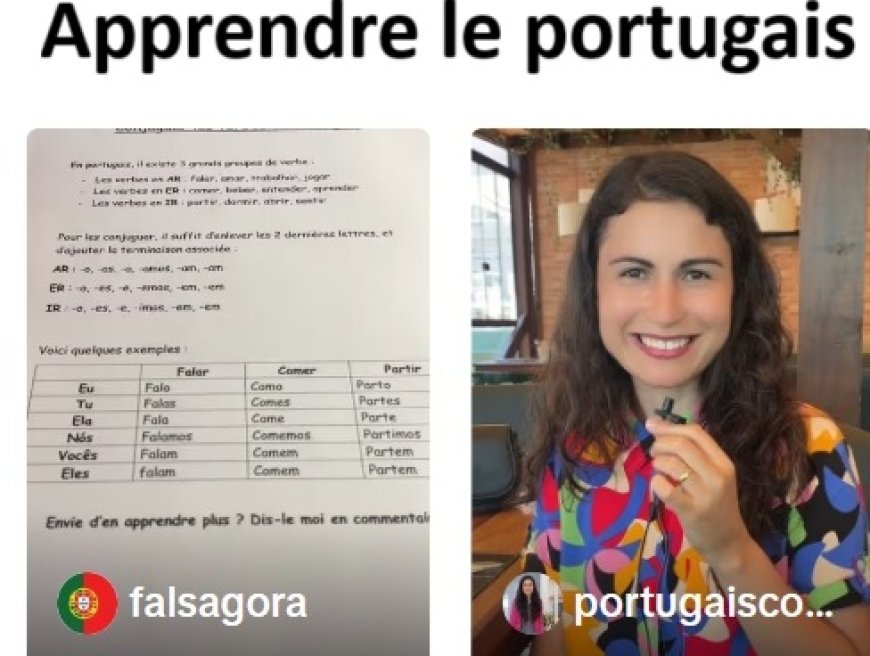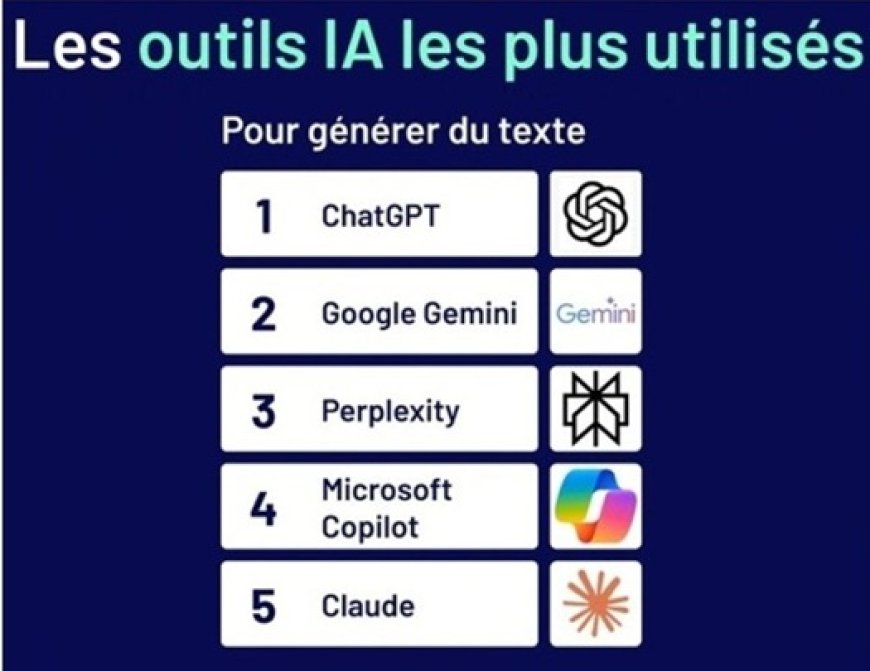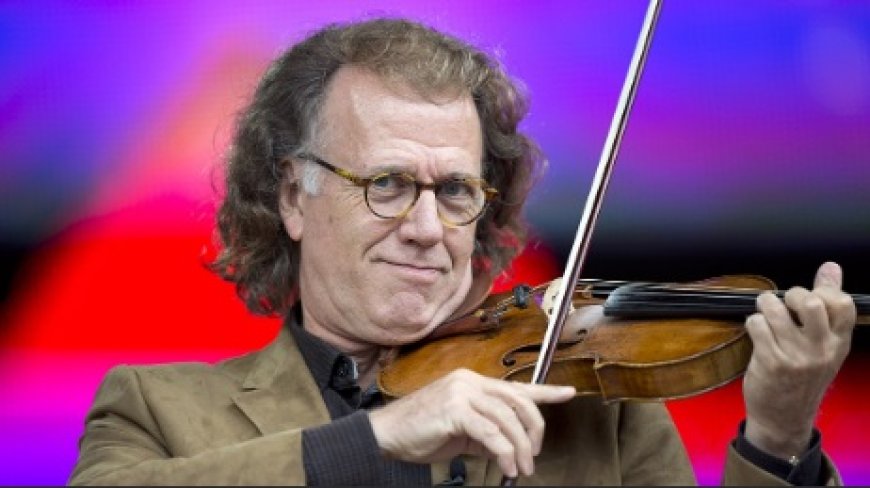Le double visage de la sieste

Qui n’a jamais cédé à l’appel d’une bonne sieste pour recharger les batteries ?
On la pare de toutes les vertus : anti-stress, alliée de la mémoire, source de récupération…
Pourtant, derrière cette image d’Épinal, une ombre se profile.
De récentes recherches françaises, menées à Montpellier, suggèrent que chez les seniors, un besoin excessif de sommeil diurne pourrait être bien plus qu’un simple signe de fatigue.
Le sommeil, ce miroir de notre vieillissement cérébral
Ce n’est un secret pour personne, notre sommeil se transforme avec l’âge. Il devient plus léger, plus fragmenté, et les nuits complètes se font plus rares. L’Institut national du sommeil et de la vigilance le confirme : on dort en moyenne une heure de moins à 80 ans qu’à 50. C’est une évolution naturelle.
Mais parfois, ces changements s’emballent. Quand les réveils nocturnes se multiplient et qu’une somnolence quasi permanente s’installe le jour, il faut peut-être y voir autre chose qu’une simple conséquence du temps qui passe. Les scientifiques y voient de plus en plus un indice d’une altération du fonctionnement du cerveau.
Une étude française qui met les pieds dans le plat
Le véritable tournant vient des travaux de Clémence Cavaillès, dont la thèse a été publiée dans des revues scientifiques de premier plan. Son équipe a suivi plus de 9 000 seniors français sur une période de 14 ans, en analysant leurs habitudes de sommeil, de sieste, et leur état cognitif.
Les résultats sont pour le moins interpellants.
Les personnes souffrant de somnolence diurne excessive ont vu leur risque de démence augmenter de 28 %.
Plus frappant encore : celles qui se sont mises à faire la sieste tardivement, ou dont les siestes se sont allongées avec le temps, ont vu ce risque grimper de 40 %. Des chiffres qui obligent à regarder notre canapé d’un autre œil.
Alors, faut-il bannir la sieste ? Pas si vite
Le but n’est pas de diaboliser ce petit somme réparateur. Une sieste courte, de 15 à 30 minutes, en début d’après-midi, conserve tous ses bienfaits pour la concentration, sans perturber le cycle nocturne. Le signal d’alerte, c’est le changement, l’excès.
Quand les siestes deviennent longues (plus d’une heure), fréquentes et incontrôlables, elles doivent mettre la puce à l’oreille. Surtout si elles s’accompagnent d’autres signes : pertes de mémoire, confusion, changements d’humeur.
Ce n’est peut-être pas la fatigue qui parle, mais un rythme veille-sommeil que le cerveau n’arrive plus à réguler.
Dans les coulisses du cerveau : une histoire de ‘nettoyage’ nocturne
Comment expliquer ce lien ?
Les chercheurs ont une piste biologique solide. Pendant que nous dormons, notre cerveau enclenche un grand ‘nettoyage’ pour éliminer les déchets métaboliques, notamment les fameuses protéines amyloïdes, impliquées dans la maladie d’Alzheimer.
Si ce mécanisme de nettoyage est défaillant, les déchets s’accumulent et endommagent les neurones. Le cerveau, épuisé par ce processus pathologique, tenterait alors de compenser en réclamant plus de sommeil. Un cercle vicieux où dormir plus ne signifie plus mieux récupérer.
Conclusion : vers une nouvelle surveillance du sommeil ?
Source: ICI.