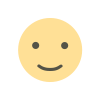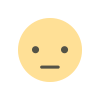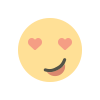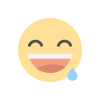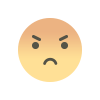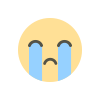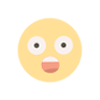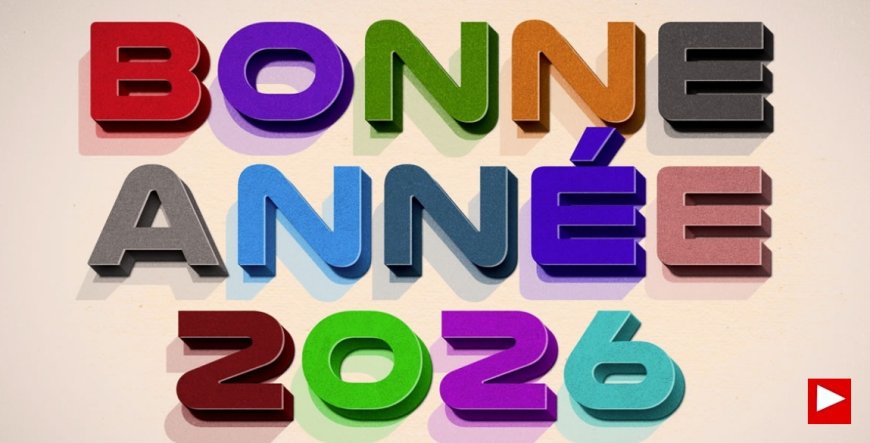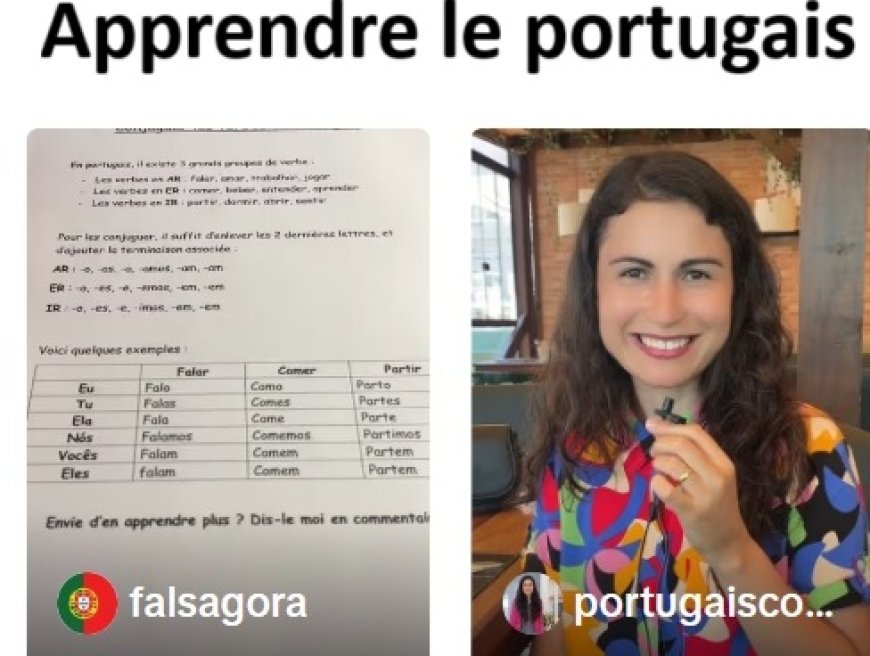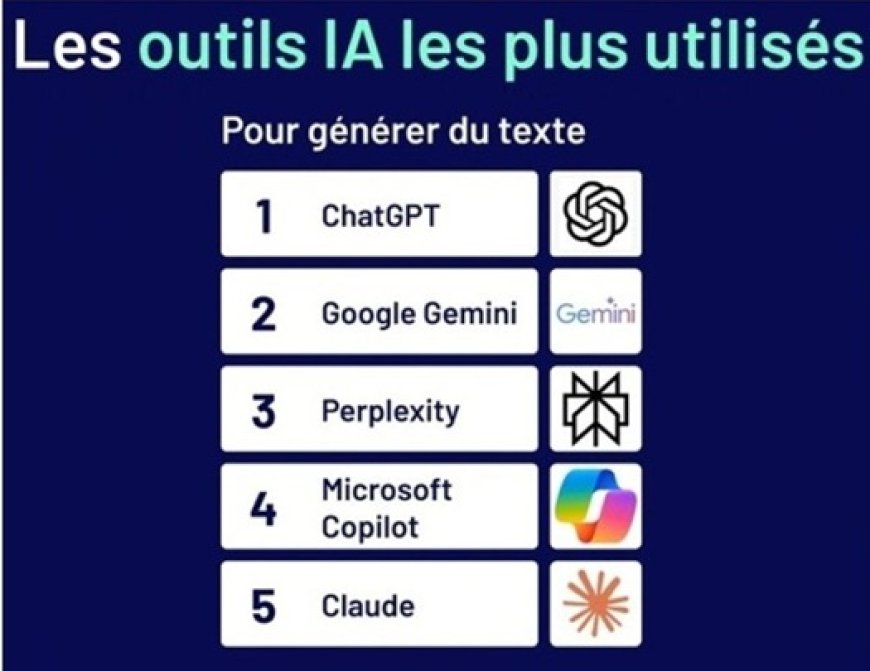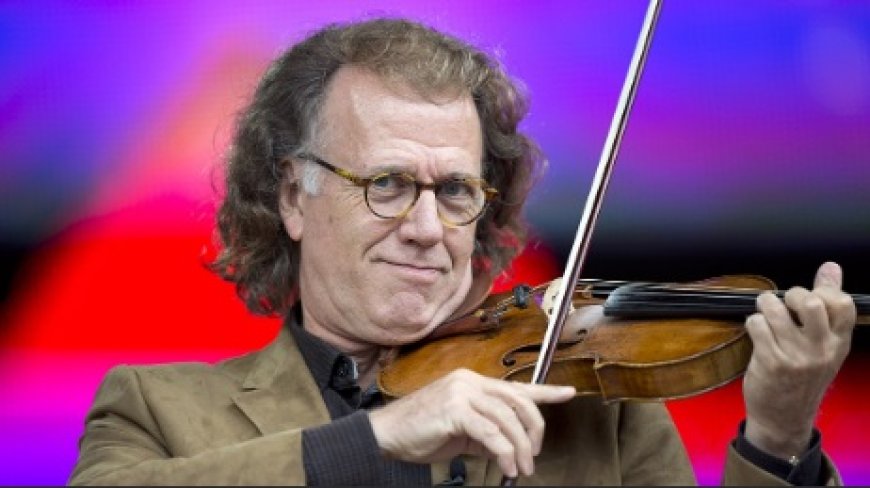Hitler = Poutine

En 1938, l’Europe est au bord de la guerre. Adolf Hitler réclame une partie de la Tchécoslovaquie, la région des Sudètes, en prétextant qu’elle est peuplée d’Allemands.
Pour éviter un conflit, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain et le chef du gouvernement français Édouard Daladier acceptent de céder cette région à l’Allemagne nazie lors d’une réunion à Munich, aux côtés d’Hitler et de Mussolini. Ce sont les accords de Munich.
À court terme, cela a semblé être une victoire de la paix : Chamberlain est même rentré à Londres en proclamant « la paix pour notre temps ». Mais en réalité, ces accords ont renforcé Hitler, qui a vu que les grandes puissances occidentales n’étaient pas prêtes à s’opposer à lui.
Quelques mois plus tard, il envahissait le reste de la Tchécoslovaquie, puis la Pologne en 1939, déclenchant la Seconde Guerre mondiale.
Cet épisode est devenu le symbole d’une erreur historique : croire qu’en cédant face à un dirigeant autoritaire, on évite la guerre, alors qu’on ne fait que lui donner plus de force et de confiance.Comme Hitler en 1938, Poutine avance ses pions :
- la Crimée en 2014,
- l’invasion de l’Ukraine en 2022,
- une volonté d’imposer son influence par la force.
La question que posent les accords de Munich à notre époque est simple : faut-il céder encore et espérer préserver la paix, ou faut-il tenir tête au risque d’un conflit plus dur ?
L’histoire nous enseigne que céder aux dictateurs ne fait pas disparaître le danger, mais le repousse et l’amplifie.
Ce parallèle entre Munich et aujourd’hui sert donc d’avertissement : la paix ne se construit pas seulement avec des compromis, mais aussi avec la fermeté face à ceux qui veulent l’écraser.
Source: RL Leucart - Metz en France