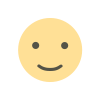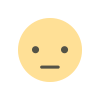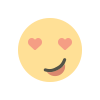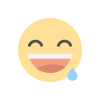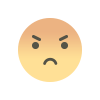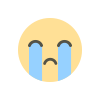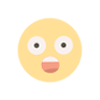Comment le corps compose-t-il avec la chaleur ?

Le réchauffement climatique met au défi la capacité du corps humain à supporter la chaleur extrême. De la transpiration à la hausse du rythme cardiaque, coup d’œil sur la réaction de notre organisme à de très chaudes températures
Mission : refroidissement
Lorsque sa température s’échauffe, le corps tente de se refroidir. Il produit de la sueur qui, en s’évaporant, permet d’abaisser la température corporelle. Aussi, le rythme cardiaque s’accélère. En battant plus vite, le cœur tente d’amener plus de sang à la surface de la peau, ce qui explique le teint rougi des personnes qui ont chaud. Le but est « d’envoyer la chaleur du corps vers la peau pour que la sueur qui est produite puisse être évaporée », expose le professeur Glen Kenny, titulaire de la Chaire de recherche en physiologie environnementale à l’Université d’Ottawa. Ainsi refroidi, le sang présent dans les capillaires de la peau est transporté vers les organes internes pour les rafraîchir.
Le cœur s’accélère, la pression baisse
« Le premier effet de la chaleur, il est cardiaque », affirme le professeur et chercheur à la faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, Thomas Deshayes, qui a mené des recherches sur le sujet à l’Institut de cardiologie de Montréal. Même au repos, dans une pièce chaude, le cœur s’accélère, ce qui expose les personnes vulnérables à des risques accrus d’ischémie ou d’arrêt cardiaque, explique-t-il. Aussi, afin d’augmenter le flux sanguin, les vaisseaux s’ouvrent, entraînant une baisse de la pression artérielle et induisant un stress sur le cœur. Tout le monde peut être à risque. « C’est très contexte dépendant, indique Thomas Deshayes. Je peux ne pas être vulnérable dans une situation X ou Y, mais s’il fait chaud et que je vais courir à l’extérieur, je vais être vulnérable, même si je suis jeune et en bonne santé. »
L’ennemi : l’humidité
Lorsque le taux d’humidité est élevé, comme c’est souvent le cas lors des canicules montréalaises, la transpiration comme mécanisme de refroidissement est moins efficace. La sueur ne pouvant s’évaporer, elle glisse simplement sur la peau sans la refroidir. « Je me déshydrate, mais je ne me refroidis pas, c’est le pire des scénarios, dit Glen Kenny. C’est ce qui fait que notre cerveau perçoit que c’est plus chaud. » La déshydratation diminue le volume sanguin, ce qui augmente encore plus le stress sur le cœur.
Ça surchauffe !
L’activité physique a une influence sur la réponse du corps à la chaleur. Par temps chaud, la chaleur produite par le corps devient encore plus difficile à évacuer, d’où les coups de chaleur pouvant frapper les athlètes et les travailleurs. Lorsque la température corporelle se situe entre 38 °C et 40 °C, on parle d’épuisement attribuable à la chaleur. La fatigue, la nausée, les maux de tête se manifestent. Passé 40 °C, on souffre d’un coup de chaleur. Le système nerveux central est défaillant. Les coups de chaleur pourraient avoir un impact à long terme. « On commence à mieux le comprendre, avance Thomas Deshayes. Un peu comme les commotions cérébrales, on est plus susceptible d’avoir un autre coup de chaleur, à des conditions ambiantes qui sont peut-être un petit peu moins chaudes que la première fois. On sait aussi que ça peut avoir des séquelles à long terme sur le cœur et les reins. »
Le cerveau
Des études ont aussi montré des effets de la chaleur sur les fonctions cognitives. Glen Kenny l’a constaté lors d’études réalisées auprès de travailleurs, notamment dans le secteur minier. « Quand les travailleurs sont en hyperthermie, plus stressés par la chaleur, ils sont moins attentifs, moins conscients des dangers autour d’eux. » La chaleur augmente aussi le stress et la propension aux comportements agressifs.
Le seuil critique
Quelle température le corps humain peut-il supporter ? Un indice de confort thermique qui tient compte du taux d’humidité (« wet bulb temperature ») a été établi pour déterminer le seuil de survivabilité. Ainsi, une exposition de six heures à une température de 35 °C et 100 % d’humidité (ou 38 °C et 80 % d’humidité, ou encore 41 °C et 60 % d’humidité) présenterait un danger mortel pour l’humain. Glen Kenny, qui mène des recherches à ce sujet dans son laboratoire, invite à la prudence face à ces données parce que « le seuil va être différent pour différents groupes de personnes ». La capacité à évacuer la chaleur peut même varier chez une même personne, d’un moment de la journée à un autre et d’une journée à l’autre. Aussi, les personnes régulièrement exposées à la chaleur deviennent plus tolérantes. Thomas Deshayes émet, pour sa part, l’hypothèse qu’un entraînement physique régulier pourrait bâtir une meilleure défense face à la chaleur.
Source
Valérie Simard La Presse